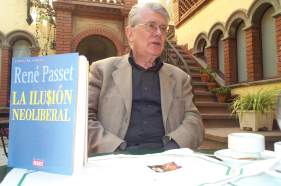 La cause est entendue : nous ne travaillons pas assez. M. Sellière l'a décrété, M. Camdessus écrit : "La quasi-totalité de l'écart de croissance qui nous sépare, depuis dix ans, de nos principaux partenaires s'explique par la moindre quantité de travail que nous sommes capables de mobiliser collectivement chaque année" (Le sursaut. Vers une nouvelle croissance pour la France - La Documentation française, octobre 2004). M. Raffarin en a tiré les conséquences : "La productivité horaire du travailleur français a beau dépasser celle de l'Américain ou du Britannique, comme il travaille moins d'heures dans l'année et moins d'années dans sa vie, sa performance globale se révèle finalement inférieure."
La cause est entendue : nous ne travaillons pas assez. M. Sellière l'a décrété, M. Camdessus écrit : "La quasi-totalité de l'écart de croissance qui nous sépare, depuis dix ans, de nos principaux partenaires s'explique par la moindre quantité de travail que nous sommes capables de mobiliser collectivement chaque année" (Le sursaut. Vers une nouvelle croissance pour la France - La Documentation française, octobre 2004). M. Raffarin en a tiré les conséquences : "La productivité horaire du travailleur français a beau dépasser celle de l'Américain ou du Britannique, comme il travaille moins d'heures dans l'année et moins d'années dans sa vie, sa performance globale se révèle finalement inférieure."Les choses sont-elles aussi simples ? En France, alors que le produit national par habitant était multiplié par plus de sept au XXe siècle, la quantité de travail annuelle fournie dans la nation régressait de 55 à 36 milliards d'heures. Pourtant, le volume de l'emploi passait de 18 à 22 millions de postes, le revenu des salariés augmentait avec le produit national et leur niveau de protection sociale s'améliorait. En d'autres termes, l'augmentation des richesses produites se trouvait équitablement répartie. Le phénomène se vérifiait ailleurs, notamment en Allemagne.
La croissance n'avait donc pas augmenté la demande globale de force de travail, mais s'accompagnait de sa réduction. Affirmer qu'elle crée l'emploi, c'est la confondre avec son accélération conjoncturelle. Dans la courte période, en effet, "toutes choses étant égales par ailleurs", c'est-à-dire notamment à technologie constante, produire plus exige transitoirement davantage de travail - donc, à durées individuelles inchangées, plus d'emplois. Mais la croissance est un phénomène long, porté à la fois par l'accumulation du capital et le progrès technique, dont la vocation est de prendre progressivement la relève du travail.
Pourquoi investirait-on s'il n'en était pas ainsi ? (…)
On peut retourner le problème dans tous les sens. Si le temps de travail individuel ne s'était pas abaissé, de 3.000 heures annuelles en 1900 à 1.600 heures un siècle plus tard, la diminution de la quantité globale d'heures ouvrées dans la nation n'aurait pu s'accompagner d'une augmentation du volume de l'emploi. C'est là une tendance lourde que l'on ne saurait négliger. Les statistiques de l'OCDE montrent que la baisse du nombre annuel d'heures travaillées par salarié se vérifie - avec des amplitudes diverses - dans toutes les nations industrialisées, Etats-Unis compris. Dans notre pays, pour nous en tenir à l'actualité récente, l'accélération des ouvertures d'emplois par rapport à l'augmentation du PIB, sur la période fin 1997/fin 2001, permet d'évaluer à environ 400.000 les créations de postes liées à ce que certains persistent à qualifier de "désastre des 35 heures". A l'opposé, depuis, la stagnation des temps de travail individuels s'accompagne non seulement d'une reprise du chômage, mais - de fin septembre 2002 à fin septembre 2004 - d'une régression de 60.000 emplois dans le secteur marchand.
On objecte le spectre des coûts et de la perte de compétitivité.
Pourtant, selon le Bureau of Labor Statistics des Etats-Unis, le coût en dollars de l'heure de travail de l'ouvrier français n'augmentait que de 11,5 % de 1990 à 2003, contre 43% pour l'Américain et 42% pour le Britannique. Après avoir été, en 1990, le plus élevé après celui de son collègue allemand, il était devenu, en 2002, le moins cher des grands pays industrialisés : 5% de moins qu'au Royaume-Uni, 25% de moins qu'aux Etats-Unis. Malheureuses firmes françaises exsangues dont, en 2004, les profits nets auront augmenté au moins trois fois plus vite que les salaires et qui, entre 2000 et 2003, auront pu consacrer 56 milliards d'euros au rachat de leurs propres titres, pour le plus grand bien de leurs actionnaires (Le Monde du 31 décembre 2004).
Pendant que l'on chipote sur le prix du travail, le cours de l'euro s'élève de 65 % en quatre ans, affectant bien plus la compétitivité de l'appareil productif que le poids des salaires. Décidément, l'argument économique ne tient pas la route. Reste le choix politique.
La réduction des temps, le salaire, la protection sociale sont les instruments d'un partage des gains de productivité constituant ce "progrès social" hors duquel on se demande quel pourrait être le sens de l'activité économique. Le chômage, à l'opposé, supprime la question du partage. Marks et Spencer, en 2001, l'avouait au moment de fermer certains de ses établissements : il s'agissait d'abord de réaliser des économies de main-d'oeuvre afin d'augmenter les distributions de dividendes.
Le modèle américain, avec son taux de chômage de 5,4 %, nous est proposé en exemple. Jean Gadrey démontre qu'il y a un lien direct entre cette performance et "la paupérisation absolue du salariat du bas de l'échelle", dont les faibles rémunérations constituent le meilleur stimulant à l'embauche : de 1969 à 2003, le PIB par habitant doublait, le pouvoir d'achat du salaire minimum horaire fédéral baissait de 36 %. Actuellement, sur 36 millions de pauvres (12,6 % de la population), plus des deux tiers des ménages comptent au moins un salarié. (…)
A ce "modèle", on pourrait opposer celui des pays nordiques. Le Danemark, au taux de chômage de 5,9 %, dont la flexsécurité - conciliant flexibilité de l'emploi et sécurité pour le travailleur - devient la tarte à la crème du discours politique sans que l'on se donne les moyens de la mettre en oeuvre. En Suède, la politique sociale, à l'opposé des Etats-Unis, se concilie pourtant avec un taux de chômage faible (5,6 % environ).
Mais nos dirigeants ont choisi la voie de l'allégement des prélèvements pour les plus riches, associé à leur alourdissement pour les autres et à l'allongement des temps de travail. Les premiers résultats sont perceptibles : 3,5 millions de pauvres (6,1 % de la population), cela peut sembler relativement peu par rapport aux Etats-Unis, mais leur nombre, après avoir diminué de 500.000 de 1998 à 2001, est reparti depuis à la hausse, et la tendance longue à la réduction du taux de pauvreté s'est retournée. (…)
Politique bornée, stimulée par un patronat prompt à pousser à l'extrême les avantages immédiats d'un rapport de force favorable, mais asphyxiant la consommation, moteur essentiel de cet accroissement des valeurs ajoutées qu'il entend s'attribuer intégralement. Cela s'appelle "scier la branche".
Articles les plus récents :
- 18/10/2005 22:39 - Inflation en zone euro : + 2,6% sur un an
- 17/10/2005 16:21 - Insécurité sociale : 7 millions de pauvres
- 16/10/2005 21:25 - Les deux tiers des CES et CEC s'insèrent dans l'emploi
- 14/10/2005 05:06 - Système U va créer 300 emplois en Indre-et-Loire
- 29/06/2005 16:21 - 15,6% des salariés sont des Smicards
Articles les plus anciens :
- 05/01/2005 19:53 - Exclusif : Des enfants de chômeurs privés de cantine





